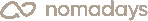Le sommet du mouvement des non-alignés Bandung
En avril 1955, la ville indonésienne de Bandung devient le théâtre d’un événement historique qui bouleverse la géopolitique mondiale, le sommet du mouvement des non-alignés. Pendant une semaine, du 18 au 24 avril, 29 nations d’Asie et d’Afrique, récemment indépendantes ou en quête d’émancipation, se réunissent pour affirmer leur souveraineté face aux tensions de la 2nde Guerre mondiale et de la Guerre froide. Refusant de se laisser absorber par l’influence des blocs de l’Est et de l’Ouest, ces pays posent les fondations du mouvement des non-alignés. Plus qu’une simple conférence diplomatique, Bandung symbolise la naissance d’une 3ème voie, marquant un tournant décisif dans l’histoire des relations internationales.
Contexte historique
Après la Seconde Guerre mondiale, le monde est profondément marqué par une division bipolaire. Deux superpuissances s’affrontent idéologiquement et politiquement :
- Le bloc de l’Ouest, dirigé par les États-Unis, défendant le capitalisme et la démocratie libérale.
- Le bloc de l’Est, sous l’influence de l’URSS, prônant le communisme et une économie centralisée.
Dans ce climat de Guerre froide, les nations nouvellement indépendantes d’Asie et d’Afrique se retrouvent sous pression pour choisir un camp. L’idée d’un rassemblement afro-asiatique prend forme lors de la réunion du Groupe de Colombo en avril 1954, réunissant l’Inde, le Pakistan, la Birmanie, le Ceylan (actuel Sri Lanka) et l’Indonésie. Ces pays, conscients de leur poids démographique et géopolitique, souhaitent renforcer leur coopération et affirmer leur indépendance face aux tensions Est-Ouest. En décembre 1954, une réunion préparatoire se tient à Bogor, en Indonésie, où sont définies les modalités d’une future conférence et la liste des invités.
C’est ainsi que la conférence de Bandung (du 18 au 24 avril 1955) voit le jour. Accueillie par le président Soekarno, elle réunit 29 pays (23 d’Asie et 6 d’Afrique), représentant une population de plus d’un milliard d’habitants.
Déroulement du sommet de Bandung
Le 18 avril 1955, la Conférence de Bandung s’ouvre dans une atmosphère de ferveur et d’espoir. Les pays présents, représentant près de la moitié de la population mondiale, se réunissent afin d’aborder les grands défis de l’époque :
- La décolonisation
- Le racisme
- Le développement économique et culturel
- La neutralité dans la Guerre froide.
Ces pays, issus d’horizons politiques et historiques variés, partagent toutefois une aspiration commune : s’émanciper de l’influence des puissances coloniales et bâtir un monde plus équitable.
Dès la cérémonie d’ouverture, le président indonésien Soekarno, fervent défenseur du non-alignement, donne le ton dans un discours marquant. Il insiste sur la nécessité pour ces peuples, malgré leurs différences culturelles, religieuses et sociales, de s’unir autour de leur expérience commune de la colonisation et de leur volonté de bâtir des relations internationales pacifiées. Aux côtés de Soekano, plusieurs figures emblématiques prennent part aux débats : Jawaharlal Nehru (inde, Gamal Abdel Nasser (Egypte), Zhou Enlai (Chine), Mohammad Ali Bogra (Pakistan) et bien d’autres.
Les discussions, souvent passionnées, reflètent la diversité des positions politiques et des priorités nationales. Plusieurs sujets sensibles sont abordés, tels que la guerre d’Indochine, la question palestinienne, la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud et les tensions en Afrique du Nord. Surnommée le « Yalta afro-asiatique », la conférence soulève également des problématiques géopolitiques majeures, notamment celles liées à la politique colonialiste de la France, aux revendications soviétiques en Turquie et en Irak, ainsi qu’aux différends concernant Taïwan et la Nouvelle-Guinée occidentale.
En outre, si Bandung marque une avancée significative pour l’affirmation des nations du Sud sur la scène internationale, les grandes puissances occidentales ne restent pas inactives. En coulisses, elles cherchent à influencer certains pays participants. Les États-Unis, en particulier, fournissent une aide économique et militaire à 20 des 29 nations représentées, témoignant de leur volonté de contrer l’émergence d’un bloc indépendant. Malgré ces pressions, la conférence de Bandung reste un moment clé où les pays décolonisés affirment leur autonomie et jettent les bases d’un nouvel ordre mondial, fondé sur la coopération entre nations du Tiers-Monde.
Résolutions et principes adoptés
À la clôture de la Conférence de Bandung, un document fondamental est adopté : les 10 principes de Bandung, inspirés des idéaux de coexistence pacifiques et des 5 principes de Panchsheel, proposés en 1954 par Jawaharlal Nehru et Zhou Enlai.
Ces principes, établissant les bases du non-alignement et de la coopération entre les pays en développement, reposent sur :
- Le respect des droits fondamentaux de l’homme et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
- La souveraineté nationale
- La non-ingérence dans les affaires intérieures des États
- Le règlement pacifique des conflits.
Ils affirment également :
- L’égalité entre toutes les nations et races
- Le rejet de l’agression
- Le refus des alliances militaires destinées à servir les intérêts des grandes puissances.
Le communiqué final de la conférence insiste sur plusieurs aspects essentiels, notamment :
- La coopération économique et culturelle
- Le respect du droit de chaque nation à se défendre individuellement ou collectivement, conformément à la Charte des Nations-Unies
- Le respect de la justice et des obligations internationales.
La conférence exprime aussi son inquiétude face aux tensions internationales et plaide pour l’interdiction des armes nucléaires et un contrôle international afin de garantir la paix mondiale. En établissant ces principes, Bandung marque une rupture avec la logique des blocs et pose les fondations du Mouvement des Non-Alignés.
Conséquences et héritage
L’un des principaux héritages du sommet de Bandung est la création, en 1961, du Mouvement des Non-Alignés lors de la conférence de Belgrade. Il a aussi permis de renforcer les mouvements indépendantistes en Asie et en Afrique. De nombreux pays, tels que l’Algérie, le Kenya et le Zimbabwe, s’inspirèrent de cette conférence pour accélérer leur lutte contre le colonialisme. Le sommet de Bandung a également marqué un changement dans la diplomatie mondiale. Il met en avant l’idée que les pays en développement pouvaient s’unir pour peser sur les décisions internationales, notamment au sein de l’ONU.
Aujourd’hui, la conférence de Bandung est perçue comme un moment fondateur de la solidarité afro-asiatique et de l’affirmation des pays du Sud sur la scène internationale. Elle incarne la volonté des nations autrefois colonisées de prendre en main leur destin et de collaborer pour un monde plus juste.
Des institutions et des événements commémoratifs perpétuent cet héritage. Par exemple, le musée de la Conférence afro-asiatique à Bandung conserve des archives et des documents liés à cet événement historique. L’esprit de Bandung a aussi inspiré des initiatives comme les BRICS et des institutions financières alternatives visant à réduire la dépendance des pays en développement aux grandes puissances. Toutefois, le non-alignement d’origine a évolué vers un multi-alignement pragmatique, où chaque pays cherche à diversifier ses alliances en fonction de ses intérêts.